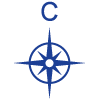
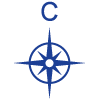
«Ayez pitié des pauvres gens dans les pays chauds où il n’y a pas de saisons. L’été y est éternel, et ils ne connaissent pas la douleur de l’attente et la joie de voir l’été enfin arriver.»
— Ray Guy
Le Parlement, au lendemain de l’incendie dévastateur de 1916. On voit encore de la fumée s’échapper du toit de l’édifice du Centre.

Un groupe d’hommes du peuple Kanien’kehá:ka (Mohawk) dans le territoire mohawk de Kahnawake, près de Montréal, en 1869. Ils viennent de remporter le championnat canadien de crosse.

Un moyen de se rafraîchir digne d’une carte postale au Château Lake Louise, en Alberta.

La caserne du Camp Borden, berceau de l’Aviation royale canadienne.

Pierre Trudeau, premier ministre du Canada, et Peter Lougheed, premier ministre de l’Alberta, en conférence de presse en 1977, alors que les esprits s’échauffent au sujet du prix du pétrole.
Au début de la colonisation au Canada, l’été signifiait le retour très attendu des saveurs et des couleurs.
Après la promesse du printemps incarnée par le sirop d’érable et l’effet tonique des premières pousses de pissenlit, l’été se déclinait en plusieurs soussaisons : la saison de la rhubarbe, la saison des fraises, la saison des bleuets, la saison des petits pois, la saison des tomates des champs, la saison des pommes. Chaque sous-saison était en soi une raison de fêter.
Grâce aux colons français d’avant la Confédération, nous avions aussi un accès facile à d’autres ingredients nécessaires aux fêtes dignes de ce nom, dont le houblon canadien, un élément essentiel de l’histoire brassicole du pays. Et avec l’abondance de maïs, de blé et de seigle, le whisky était toujours à la portée des Canadiens. Il y avait d’ailleurs plus de 200 distilleries en exploitation avant la Confédération.
Aujourd’hui, comme la grande majorité d’entre nous (du moins ceux établis dans le Sud du pays) ont accès à tous les aliments possibles et imaginables (ou presque) à l’année, le cycle annuel de nos produits d’été n’est plus attendu avec autant d’impatience. À l’ère où on peut se procurer des tomates de serre potables à l’année, la récolte des premières tomates de champ mûres donne-t-elle la même raison de se réjouir qu’il y a 150 ans? L’adage qui dit « loin des yeux, près du coeur » (ou du palais) est peut-être vrai, après tout.

Pendant plus d’un siècle, les étés canadiens ont été rythmés par le retour du football. L’école est finie, les chalets ouvrent et des hommes de 130 kg trouvent une autre bonne raison de se foncer dedans.
Au Canada, les origines du football remontent à 1861, avant la Confédération. Cette année-là, l’Université de Toronto enregistre son premier match de rugby, l’ancêtre du football canadien. Le premier règlement codifié du football canadien tel que nous le connaissons aujourd’hui est adopté en 1903. Peu de temps après, le Gouverneur général de l’époque, le Comte de Grey, cherche à récompenser la meilleure équipe du pays en lui décernant un trophée d’argent, tout comme son prédécesseur Lord Stanley de Preston avait fait pour le hockey. En 1909, quand la Coupe Grey est remise pour la première fois, les joueurs canadiens s’affrontent avec aplomb depuis presque un demi-siècle déjà.
Même si la Ligue canadienne de football fait pâle figure à côté de sa cousine américaine, la National Football League, les matchs disputés de Montréal à Vancouver attirent régulièrement des dizaines de milliers de spectateurs, et la Coupe Grey demeure un des événements sportifs télévisés récoltant les plus hautes cotes d’écoute. Ce sport est surtout populaire dans l’Ouest canadien : à Regina, le stade Mosaic devient la cinquième agglomération en importance de la Saskatchewan quand les Roughriders jouent. À Winnipeg, les Blue Bombers transforment quant à eux l’Investors Group Field en troisième ville en importance du Manitoba.
Mais un autre football, dont les origines sont aussi lointaines (sinon plus) que celles du football canadien, devient depuis quelque temps un autre incontournable des étés canadiens.
Le soccer, football association ou tout simplement football – appelezle comme vous voulez – est aujourd’hui le sport le plus populaire au Canada, si on mesure le taux de participation. Bien que les matchs de soccer disputés à Victoria et à Toronto remontent au moins aux années 1860, le pays a mis beaucoup plus longtemps avant de s’échauffer devant ce sport qu’il l’a fait pour le football, le hockey ou le baseball.
Étant donné que tous les pays sauf les États-Unis ont érigé le soccer en religion, il est tout de même déconcertant que ce sport ait mis autant de temps à se tailler une place dans l’imaginaire canadien.
Même les tendances d’immigration ne suffisent pas à expliquer ce délai. S’il est vrai que les politiques d’immigration d’après les années 1960 ont ouvert les portes à des arrivants des quatre coins du globe et ainsi encouragé la récente croissance en popularité du sport, le soccer était tout aussi prisé des populations britanniques, italiennes et allemandes qui constituaient la majorité des immigrants de la première moitié du XXe siècle.
Étant donné que 95 % de la population canadienne est non autochtone, il est possible que les affiliations aux équipes du pays d’origine aient freiné la croissance du sport au pays. Ici, presque tous les partisans du soccer applaudissent l’équipe d’un autre pays dans les tournois internationaux de soccer masculin, une idée que l’habitant typique de São Paolo, de Londres ou de Séoul trouverait tout à fait incongrue.

Pour le soccer féminin, par contre, c’est une autre histoire. Dirigée par Christine Sinclair, notre équipe nationale attire les regards et suscite les conversations. Nous sommes peut-être le seul pays au monde où le soccer national féminin reçoit plus d’attention que le masculin.
Par ailleurs, le soccer est de loin le sport d’équipe le plus populaire auprès des femmes et des filles au Canada. Le taux de participation féminin est presque égal au taux masculin (12 % contre 14 %). En contraste, de l’ensemble des sportifs au Canada, environ 17 % des sportifs masculins jouent au hockey, contre seulement 4 % des sportives, tandis que le taux de participation féminine au football américain est pratiquement nul.
Si on ajoute le coût prohibitif de l’équipement de football, ses règles complexes et ses stratégies qu’on met une vie à maîtriser, en plus de l’agression et de la brutalité physique inhérentes au sport, on comprend facilement pourquoi les jeunes ne font pas la file pour s’inscrire dans l’équipe.
Mais ce ne sont pas seulement les tendances en matière de participation aux loisirs qui changent. Le Major League Soccer, qui compte aujourd’hui des clubs à Toronto, à Montréal et à Vancouver ainsi qu’un peu partout aux États-Unis, a enfin démontré que le soccer professionnel est viable en Amérique du Nord, même si le niveau du jeu est bien inférieur à celui des équipes européennes ou sud-américaines. Au Canada, il est plus facile de suivre les matchs de soccer de la Premier League d’Angleterre, de la Bundesliga allemande ou de la Liga espagnole, ou encore de suivre le tout sur Twitter, où le sport submerge les gazouillis du samedi matin.
Pour l’instant, les cotes d’écoute des matchs de soccer au pays n’arrivent pas à la cheville de celles du football, mais la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015, dont les matchs se sont déroulés partout au pays, a généré des chiffres record. Un Canadien sur dix (ce qui représente 3,2 millions de personnes) a regardé le match revanche du Canada contre les États-Unis, et environ un sur sept (5 millions) a regardé la finale de la Coupe du monde masculine de la FIFA en 2014. Ce chiffre est supérieur aux 4,3 millions de téléspectateurs qui ont suivi la Coupe Grey en 2015, mais il est encore bien inférieur aux 8,3 millions de Canadiens qui ont regardé la diffusion du Super Bowl 2016.
Le débat millénaire quant à savoir comment appeler deux sports si différents avec le même nom fera sans doute rage pendant de nombreuses années encore. Le football (de type canadien ou américain) domine encore le petit écran, mais, tout comme la télévision en tant que média, il est ébranlé dans ses fondations mêmes. Ce que les Européens nomment le football (notre soccer à nous) échauffe les muscles des jeunes Canadiens depuis des décennies et pourrait bien arriver au point d’ébullition d’un moment à l’autre.
NOS ARDENTES MALADRESSES :
Nous, Canadiens, sommes curieux et inventifs de nature. Le goût de l’exploration coule dans nos veines, et c’est peut-être à cause de la grandeur infinie de notre pays. Cette quête d’exploration a mené à des découvertes dans plusieurs domains (l’insuline, la fermeture éclair, la poutine...), mais elle a aussi entraîné son lot de déceptions. Peut-être laissonsnous trop souvent nos émotions prendre le dessus? Ou nos plans bien intentionnés sont-ils parfois trop rigides pour que nous nous rendions compte quand quelque chose ne tourne pas rond? Peu importe la cause de nos maladresses, une chose est sûre : nous carburons à la passion.
La Bricklin SV-1
Fabriquée et assemblée au Nouveau-Brunswick par Malcolm Bricklin, millionnaire américain et fondateur de Subaru, la Bricklin SV-1 est conçue pour devenir la voiture sport sécuritaire de l’avenir (SV-1 est l’abréviation de « Safety Vehicle 1 », soit « Véhicule sécuritaire 1 »). Toutefois, en raison de ses caractéristiques de sécurité supplémentaires, elle est si lourde qu’elle ne peut pas faire ce que font les véhicules sport, c’est-à-dire se déplacer rapidement. Seulement 2 584 véhicules seront fabriqués avant que la production soit interrompue en 1975. Le véhicule au destin catastrophique passera à l’histoire comme étant la pire automobile de tous les temps.
La première ambulance de Vancouver
Pour les Canadiens, l’investissement dans le système public de santé n’est pas sujet aux débats. Le 6 octobre 1909 est un grand jour : on teste la première ambulance motorisée dans les rues de Vancouver. Mais l’ironie du sort veut que l’ambulance frappe un touriste américain, qui devient sa première victime... heu, son premier patient.

Le fusil Ross
À la suite d’une petite querelle diplomatique entre le Canada et le Royaume-Uni, qui refuse d’autoriser la production canadienne du fusil Lee-Enfield, Sir Charles Ross prend l’initiative de financer une usine pour fabriquer un fusil qu’il a lui-même conçu. Ce fusil parfait pour la chasse se révèle désastreux pendant la Première Guerre mondiale. Il s’enraye (en raison de la boue) ou surchauffe (en raison des tirs répétés), quand ce n’est pas tout simplement la baïonnette qui tombe par terre. En 1916, lors de la bataille de la Somme, c’en est assez : on ordonne le remplacement de tous les fusils Ross.

Les Jeux olympiques de 1976
Lorsqu’elles décident d’accueillir les athlètes du monde, la plupart des villes hôtes des Jeux olympiques rêvent de laisser un héritage durable, mais elles recherchent aussi une présence sur le podium et des jeux sans accrocs. L’héritage laissé par Montréal en 1976 n’a rien d’inspirant. Parmi les problèmes, citons le toit rétractable défectueux du Stade olympique, une tour d’observation qui ne sera prête qu’après la fin des Jeux olympiques et un grand total de zéro médaille pour le pays hôte. À la fin des Jeux, Montréal se retrouve avec une dette d’un milliard de dollars qu’elle mettra 30 ans à rembourser. Quel bel héritage!

